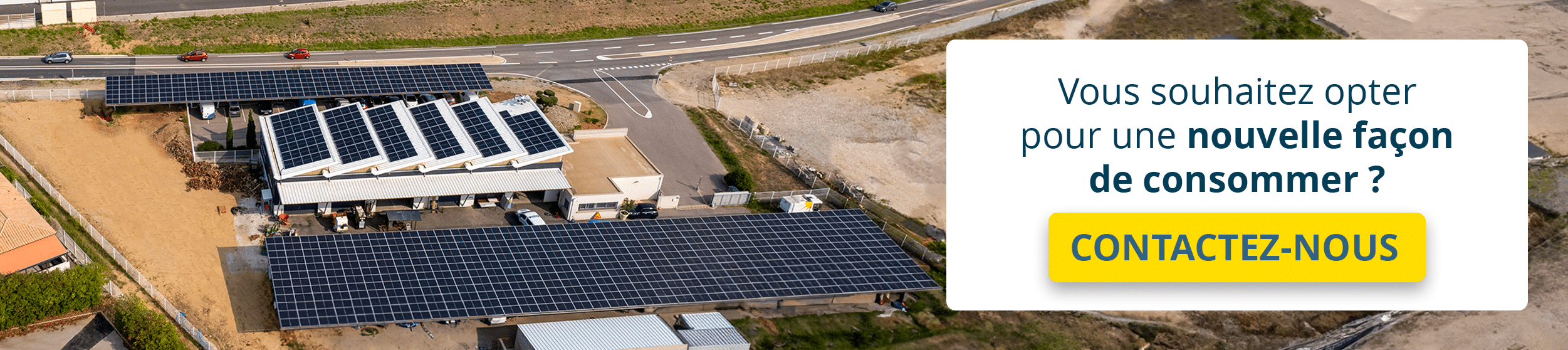Autonomie énergétique des territoires : quels enjeux ?
L’autonomie énergétique est au cœur de multiples défis : production d’énergies renouvelables et récupérables (EnR&R), stockage, économies d’énergie, changements de comportement, essor des réseaux électriques intelligents, économie circulaire…Mener une démarche d’autonomie énergétique, c’est tirer profit des ressources du territoire pour limiter sa dépendance aux sources d’approvisionnement externes. La relocalisation de la production et de la consommation d’énergie nécessite d’accélérer le passage d’un système centralisé à de multiples systèmes décentralisés, ayant un potentiel d’indépendance, d’autosuffisance. Apex Energies, entreprise d’énergie renouvelable à Montpellier fait le point sur les enjeux de l’autonomie énergétique des territoires.
C’est quoi l’autonomie énergétique ?
Selon l’Agence de la Transition écologique (Ademe), « l’autonomie énergétique qualifie la faculté d’un groupe à maîtriser plus ou moins son avenir énergétique. […] L’autonomie ne passe pas seulement par la mobilisation des énergies renouvelables puisque la sobriété et l’efficacité des bâtiments et de la distribution d’énergie lui sont aussi associées. Le stockage est désormais associé à cette notion d’autonomie […] ».
Regnier Y., Landel P.A. et L. Durand en proposent une autre définition : « La capacité d’un territoire à optimiser le bouclage des flux énergétiques, d’une part, mais aussi à maîtriser la mise en œuvre des trajectoires de transition énergétique (humaine, organisationnelle, financière, démocratique, décisionnelle), d’autre part ».
Un territoire autonome en énergie, c’est un territoire ayant atteint un niveau de production d’énergies couvrant, sur une année, ses besoins. La notion d’autonomie énergétique est distincte de deux autres concepts :
-
L’autoconsommation, relative à la consommation de sa propre production d’électricité.
-
L’autarcie énergétique, consistant à s’affranchir de tout réseau de distribution (électricité, gaz). Un territoire autarcique est autonome à 100 % en énergie.
Les trois leviers de l’autonomie énergétique des territoires
Minimiser les besoins énergétiques, assurer la transition vers une production d’énergie renouvelable locale, optimiser l’adéquation entre l’offre et la demande énergétique… Les solutions pour renforcer l’autonomie énergétique des territoires ne manquent pas. Quels moyens d’action ont-ils à leur disposition pour parvenir à un équilibre entre leur consommation d’énergie et les capacités locales à y répondre ?
Repenser la politique spatiale des territoires
L’organisation de l’espace a un impact sur les besoins en énergie d’un territoire. Si les activités sont éloignées les unes des autres, les déplacements sont démultipliés. Dans ce cadre, la politique spatiale œuvre difficilement à la diminution de la consommation énergétique. Pour y contribuer, il est essentiel de rapprocher les activités pour limiter, voire combiner, les déplacements (4). La promotion de la mobilité douce a un rôle à jouer en ce sens.
Le rapprochement géographique d’activités aux besoins énergétiques différents facilite la régulation de la production et de la consommation d’énergie (5). Les pics de consommation sont lissés dans le temps, permettant de réduire les besoins en stockage, les pertes énergétiques.
Stimuler la transition vers une production d’énergie renouvelable 100 % locale
Une production d’énergie durable passe par le développement de l’utilisation des ressources renouvelables disponibles localement :
-
Énergie solaire ;
-
Géothermie ;
-
Réseaux de chaleur ;
-
Éolien ;
-
Biomasse ;
Pour être viable, le recours aux énergies renouvelables (EnR) doit prendre en compte l’intégration paysagère des installations. L’idéal est d’inscrire les projets dans de véritables dynamiques collectives, incluant les acteurs locaux, dont les citoyens.
Mutualiser les échanges avec les communautés d’EnR
La concordance entre l’offre et la demande en énergie fait partie des enjeux pour limiter l’utilisation de solutions de stockage, parfois difficiles à mettre en œuvre. Sur le territoire, l’organisation de l’espace doit permettre un échange de flux résiduels de chaleur et d’énergie pour combler une partie des besoins en énergie. Pour garantir un bon échange de l’énergie, les réseaux doivent être couplés au niveau local, tout en étant reliés aux réseaux de distribution globaux (6).

La loi Énergie Climat du 8 novembre 2019
Cette loi transpose la notion de « communauté d’énergie renouvelable » en droit français.
Une communauté d’énergie renouvelable prend la forme d’une entité juridique autonome. Elle est basée sur une participation volontaire de personnes physiques, de petites et moyennes entreprises (PME), de collectivités territoriales (ou leurs groupements). La communauté a l’autorisation de produire, consommer, stocker, vendre de l’énergie renouvelable. Elle peut aussi la partager entre ses membres. Les communautés énergétiques constituent un nouveau levier d’intervention locale en faveur de l’autonomie énergétique des territoires (7). Voir la mise à jour du TURPE 6.
Les bénéfices de l’autoconsommation collective pour l’autonomie énergétique
L’autoconsommation collective est une solution innovante et de plus en plus utilisée pour permettre aux territoires de tendre vers une autonomie énergétique. Ce modèle repose sur la production et la consommation locale d’énergie renouvelable, principalement solaire, éolienne ou issue de la biomasse, par un ensemble de participants regroupés au sein d’une même communauté énergétique. Voici les principaux bénéfices de cette approche :
1. Réduction de la dépendance aux réseaux d’énergie conventionnels
L’autoconsommation collective permet aux territoires de réduire leur dépendance vis-à-vis des réseaux nationaux d’électricité et des énergies fossiles. En produisant localement une partie ou la totalité de l’électricité consommée, les communautés peuvent s’affranchir des fluctuations des prix de l’énergie sur les marchés mondiaux. Cette indépendance est particulièrement avantageuse dans un contexte où les prix de l’électricité sont en hausse, offrant une sécurité énergétique accrue aux participants.
2. Optimisation des ressources renouvelables locales
Ce modèle repose sur l’utilisation d’énergies renouvelables locales, telles que le solaire ou l’éolien, qui sont adaptées aux spécificités géographiques des territoires. En mutualisant les ressources entre plusieurs utilisateurs, l’autoconsommation collective permet d’optimiser la production d’énergie et de minimiser les pertes liées à la distribution. Cela permet une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique local, favorisant ainsi la transition énergétique.
3. Réduction des coûts énergétiques pour les participants
L’un des principaux attraits de l’autoconsommation collective est l’économie d’énergie qu’elle permet de réaliser. En produisant et consommant de l’électricité localement, les participants évitent les coûts liés au transport de l’énergie sur les réseaux longue distance, ainsi que les taxes et frais associés. De plus, ils peuvent vendre les surplus d’électricité non consommée à des tarifs avantageux, générant ainsi un revenu complémentaire pour amortir leur investissement initial. À long terme, ces économies peuvent représenter une part significative des coûts énergétiques.
4. Contribution à la résilience énergétique des territoires
L’autoconsommation collective renforce la résilience des territoires face aux crises énergétiques ou aux pannes de réseau. En cas de coupure du réseau électrique principal, les installations locales peuvent continuer à fournir de l’électricité, assurant ainsi une continuité de service pour les membres de la communauté. Cela est particulièrement important dans les zones rurales ou éloignées, où les interruptions de service peuvent être plus fréquentes.
Devenir acteur de l’autonomie énergétique de son territoire avec Apex Energies
Depuis plus de 30 ans, Apex Energies met tout son savoir-faire au service de la révolution énergétique des territoires. Notre groupe conçoit des solutions sur mesure pour vous permettre de gagner en autonomie énergétique tout en optimisant la gestion de vos ressources. Nous vous accompagnons dans la migration vers un nouveau modèle de production plus responsable, économe, respectueux de l’Homme, comme de l’environnement.
Contactez un conseiller Apex pour échanger sur votre projet photovoltaïque en autoconsommation.
Les 3 points essentiels de l’autonomie énergétique :
-
Pour un territoire donné, l’autonomie énergétique consiste à couvrir ses besoins en énergie.
-
La politique spatiale, la production d’EnR, l’optimisation des échanges d’énergie font partie des leviers d’action pour accélérer l’autonomie des territoires.
-
Les communautés énergétiques sont un outil intéressant pour favoriser l’émergence d’une alliance entre autorités locales et groupements de citoyens.
1 https://amienscluster.com/autonomieenergetique/
4, 5, 6 https://territoire.charleroi-metropole.be/2-axes-8-strategies/viser-lautonomie-energetique-du-territoire-et-le-zero-carbone
7 https://www.smartgrids-cre.fr/encyclopedie/les-communautes-energetiques-locales/au-dela-de-lautoconsommation-concept-de-communautes-energetiques